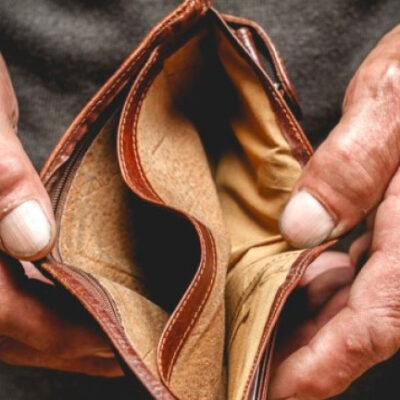Chaque octobre, le Bénin vit au rythme du « Mois du Consommons Local », une initiative régionale UEMOA pour célébrer les biens et services du terroir. La dernière édition organisée à Cotonou a rassemblé des centaines d’exposants et un public nombreux, preuve que la fierté d’acheter béninois progresse.
Mais au-delà de l’élan, quel est l’impact réel sur notre économie et notre assiette ? En 2024, la FAO estimait la production céréalière du pays à environ 2,9 millions de tonnes, un niveau supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Pourtant, notre autosuffisance en riz plafonne autour de 25–27 %, obligeant encore à importer. Autrement dit : nous produisons plus, mais nous ne consommons pas encore assez local. Voilà le paradoxe à résoudre.
1) Pourquoi consommer local en chiffres…
- Sécurité alimentaire & balance commerciale
Selon l’INStaD, l’autosuffisance en riz est restée sous 30 % en 2022-2023, un signal d’alerte pour un aliment de base. En parallèle, le Bénin a importé en 2023 330 M $ de « foodstuffs » (catégorie OEC) et 691 M $ de céréales (toutes origines confondues) : chaque assiette importée alourdit la facture extérieure. Réduire cette dépendance passe par la montée en gamme et la préférence locale.
- Pouvoir d’achat & prix
En 2023-2024 la BCEAO observe un reflux des prix mondiaux de plusieurs produits importés, mais cette accalmie reste volatile. Miser sur des filières nationales robustes amortit mieux les chocs.
- Emploi & valeur ajoutée
Le Bénin demeure l’un des premiers producteurs africains de coton, et la transformation locale (GDIZ, parcs textiles) exporte désormais des vêtements « Made in Benin » vers l’Europe et les États-Unis : un signal fort de création d’emplois et de capture de valeur sur place.
2) Trois filières qui tirent le mouvement
a) Le riz : du champ à la table, une montée en puissance
La production de riz (paddy) atteint près d’un demi-million de tonnes en 2023-2024 (≈ 492 626 t, chiffres définitifs INStaD), malgré une légère baisse sur un an. Les rendements tournent autour de 3,7–4,1 t/ha selon les sources techniques, et la FAO confirme une dynamique céréalière au-dessus de la moyenne récente. Des programmes publics visent à porter l’offre vers 1 million de tonnes de paddy à l’horizon 2026. En face, la consommation nationale reste élevée : il faut donc accélérer la structuration, la qualité et la distribution.
Zoom marque SORIZ (Zogbodomey). SORIZ se spécialise dans les riz complets “colorés” (rouge, noir) et semi-blanchis, issus d’agriculture écologique. L’entreprise investit la transformation et la commercialisation en circuits modernes, positionnant un riz nutritif et différenciant face aux importations blanches asiatiques. Plusieurs vitrines digitales documentent la gamme et le modèle en cluster. Pour le consommateur, c’est l’assurance d’un produit local traçable, plus riche en fibres et minéraux (par rapport à des équivalents très raffinés).
Le défi à relever. Malgré cette dynamique, l’autosuffisance en riz demeure faible (≈ 25–27 %). Les priorités : uniformiser la qualité (calibrage, taux de brisure), agrandir les volumes réguliers, et inonder le retail urbain (GS, e-commerce) pour faire basculer les habitudes d’achat.
b) L’agro-transformation & la distribution locale : le cas Jinukun
Jinukun s’est imposée comme marketplace et chaîne de distribution de produits agricoles et agroalimentaires béninois : huiles, farines, épices, jus, céréales, viandes, fruits & légumes… Avec une plateforme e-commerce opérationnelle, des boutiques et une présence active sur les réseaux, la marque connecte producteurs, transformateurs et consommateurs urbains. C’est une pièce manquante du puzzle « consommer local » : la disponibilité et la convenience.
Ce que cela change. En apportant visibilité, logistique et confiance (marquage, traçabilité), Jinukun fait gagner des parts de marché aux produits béninois dans les paniers de Cotonou, Porto-Novo ou Parakou. Chaque fois qu’un jus de mangue local, une farine d’igname ou une huile d’arachide est livrée à l’heure, la préférence s’installe.
c) Le cuir & la cordonnerie haut de gamme : Fathnell, l’argument premium
La cordonnerie de luxe n’est pas l’apanage des capitales européennes. À Cotonou, FathNell fabrique à la main sandales, ceintures, sacs, chaussures et accessoirres en cuir, avec un soin porté au design et aux finitions. La marque revendique le “handmade in Benin”, assume une esthétique premium et capitalise sur la personnalisation. Résultat : un produit statutaire qui légitime l’idée qu’acheter local, c’est aussi acheter mieux.
Pourquoi c’est stratégique. Le haut de gamme tire toute la filière (tanneurs, artisans, détaillants), améliore les marges, attire la presse et fait bouger les représentations : non, le local n’est pas une option par défaut ; c’est un choix de style et de qualité.
3) Textile « Made in Benin » : de l’or blanc aux dressings
Le Bénin est revenu au coude-à-coude avec le Mali en tête de la production africaine de coton-graine (ordres de grandeur : 590–640 000 t selon les campagnes récentes). L’enjeu n’est plus de prouver que nous savons produire, mais de transformer filature, tricotage, teinture, confection et de vendre des vêtements finis. C’est le pari tenu par la GDIZ, qui a déjà expédié des lots “Made in Benin” à des enseignes européennes (Kiabi, US Polo Assn) : un saut qualitatif pour la chaîne de valeur.
Ne se contentant plus de produire le conton, le Bénin façonne son image à travers le design. Prenons l’exemple de Lolo Andoche, créateur depuis près de 20 ans, qui réalise un chiffre d’affaire de plusieurs millions avec plus d’une soixantaine d’employés, et place la filière locale au cœur de sa marque. Sa collection Atcho (2018) illustre ce choixx délibbérré du coton béninois, teinté et tissé sur place.
Durabilité & labels. Les parcs textiles annoncent des approvisionnements traçables et certifiés “Cotton made in Africa”, un atout pour pénétrer les marchés exigeants. Cet alignement entre production responsable et compétitivité est clé pour capter des commandes régulières.
4) Des politiques publiques et événements qui changent l’échelle
- Mois du Consommons Local. Au-delà des stands et des concerts, les foires d’octobre (Place de l’Amazone, Cotonou) structurent l’offre en zones thématiques et donnent de la visibilité aux PME. L’enjeu désormais : prolonger l’effet « octobre » toute l’année (achats publics, centrales d’achat, distribution).
- Cap sur la transformation. L’État et ses partenaires promeuvent une industrialisation textile (GDIZ), l’accélération rizicole (programmes & objectifs paddy), et des actions de structuration de filières pour substituer des importations. Ces chantiers, s’ils sont reliés à la demande locale, feront bouger l’aiguille.
5) Des gestes concrets pour le consommateur et pour les marques
Pour le consommateur
- Identifier les marques locales fiables (étiquetage, origine) : SORIZ pour des riz complets/semis, Jinukun pour un panier 100 % local, FathNell pour la maroquinerie, etc.
- Tester des alternatives : remplacer un riz blanc importé par un riz rouge/noir SORIZ dans un plat en sauce ; troquer une ceinture importée contre une ceinture FathNell.
- Acheter en ligne ou en boutique : la disponibilité n’est plus un frein (Jinukun, points de vente physiques).
Pour les marques locales
- Qualité & constance : standardiser (calibre, emballage, infos nutritionnelles) et livrer à l’heure.
- Storytelling & preuve : communiquer sur origine, méthodes, labels et publier des analyses (valeurs nutritionnelles, empreinte).
- Distribution multicanale : retail moderne + e-commerce + Horeca ; viser aussi les achats publics (cantines, hôpitaux) pour sécuriser les volumes.
6) Quatre idées reçues… et la réalité
- « Le local est trop cher » → Pas toujours : la baisse des prix mondiaux est volatile ; un produit local stable réduit les coûts cachés (délais, rupture, change).
- « Le local est moins bon » → La montée en gamme (FathNell) et les labels (CmiA) prouvent l’inverse.
- « On ne produit pas assez » → Vrai pour certains postes (riz), mais la production céréalière 2024 est élevée, et le textile exporte déjà. La marge de progrès, c’est la préférence d’achat.
- « Le design local n’exporte pas » → Faux : des marques exportent (Kiabi, US Polo Assn via GDIZ) et des créateurs portent un design export-ready.
Le « Consommons local » n’est pas qu’un slogan d’octobre. Les chiffres disent qu’il peut devenir une stratégie nationale : plus de 2,9 Mt de céréales en 2024, une industrie textile qui exporte déjà, des marques qui prouvent qu’un produit fait au Bénin peut être bon, beau et compétitif.
Reste à transformer l’essai : si chaque ménage substituait ne serait-ce que 2–3 achats par semaine par des équivalents locaux, l’effet cumulé sur l’emploi, la balance commerciale et la résilience serait massif. La prochaine fois que vous remplissez votre panier, demandez-vous : quelle part de mon ticket soutient un producteur, un artisan, un designer d’ici ? C’est ainsi qu’un réflexe devient un levier de développement.