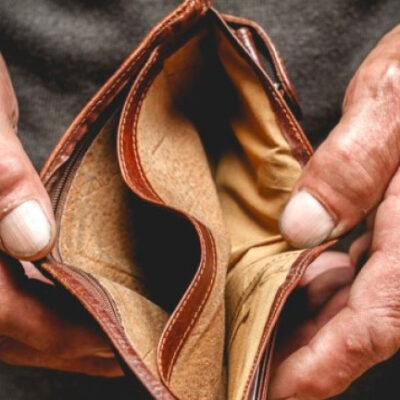En février 2024, la Berlinale consacrait le film Dahomey de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, qui remporta l’Ours d’or, la plus haute distinction du festival. Derrière cette reconnaissance internationale se cache une œuvre singulière : un documentaire poétique et politique qui suit le retour au Bénin de 26 trésors royaux du royaume du Dahomey, pillés par la France en 1892 et conservés au musée du quai Branly à Paris.
Plus qu’un simple reportage sur la restitution, le film prend le parti d’offrir une voix à l’un de ces objets, la “statue numéro 26”, qui raconte son exil forcé, son séjour en Europe et son retour au pays natal. Ce choix narratif bouleverse les codes et fait de l’objet un témoin vivant de l’histoire coloniale, un acteur de mémoire qui parle au présent.
Quand les objets prennent la parole
La force de Dahomey réside dans son dispositif artistique. Mati Diop confie à l’écrivain haïtien Makenzy Orcel l’écriture de la voix off de la statue, qui devient personnage central. Cette parole imaginaire n’a rien d’artificiel : elle exprime la douleur, la nostalgie, mais aussi la dignité d’un patrimoine arraché puis restitué.
À travers cette voix, le spectateur comprend que les objets ne sont pas seulement des témoins muets, mais des dépositaires de mémoire collective. Ils portent en eux les récits des rois, des prêtres, des guerriers et des communautés qui les ont façonnés et honorés. L’objet devient une personne, un miroir tendu à l’Afrique contemporaine.
L’autre dimension clé du film réside dans la parole donnée aux étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, qui débattent de l’avenir de ces trésors. Entre fierté retrouvée et interrogation sur leur place actuelle, leurs échanges incarnent la vitalité d’une jeunesse qui se saisit de son histoire pour imaginer l’avenir.
Mémoire, identité et justice patrimoniale
À travers Dahomey, Mati Diop met en lumière un débat brûlant : celui de la restitution des biens culturels africains. Si le retour des 26 trésors du Dahomey en 2021 fut salué comme une victoire diplomatique, le film rappelle que des milliers d’autres objets africains demeurent encore dans les musées occidentaux.
Ce geste de restitution soulève des enjeux multiples :
-
Identitaires : réintégrer ces œuvres dans leur pays d’origine, c’est redonner à une nation les fragments de son histoire dispersée.
-
Culturels : leur présence dans les musées béninois nourrit l’éducation, la recherche et la transmission.
-
Politiques : elle redéfinit les rapports entre l’Afrique et l’Occident, autour d’un dialogue plus équilibré et respectueux.
Le film de Diop n’est pas un simple plaidoyer, il est une méditation visuelle et sonore. Ses plans contemplatifs, son travail sur l’ombre et la lumière, la musique de Wally Badarou et Dean Blunt, créent une atmosphère presque spirituelle. Le spectateur ne reçoit pas un cours d’histoire, mais vit une expérience sensible, où la mémoire devient palpable.
Une résonance particulière pour le Bénin
Pour le public béninois, Dahomey a une résonance profonde. Il met en lumière des trésors arrachés à Abomey et aujourd’hui conservés au Musée de l’Épopée des Amazones et des Rois du Danxomè. Le film rappelle que ces objets ne sont pas des reliques, mais des symboles vivants de l’identité nationale.
En donnant la parole à une génération d’étudiants, il ouvre un débat essentiel : comment accueillir ces œuvres dans le présent ? Doivent-elles rester des objets de musée, ou peuvent-elles inspirer la création contemporaine ? Quelle mémoire veulent-elles transmettre aux générations futures ?
Ces questions résonnent avec les enjeux du mois d’Octobre placé sous le signe du “Consommons local” : de la même manière qu’on valorise les produits du terroir, il s’agit aussi de réapprendre à valoriser nos patrimoines immatériels et matériels, à reconnaître leur valeur et à en faire un levier de fierté collective.
Conclusion
Avec Dahomey, Mati Diop signe une œuvre majeure, à la croisée de l’art, de l’histoire et de la politique. En donnant voix aux objets pillés et restitués, elle rappelle que la culture n’est pas un décor figé, mais une force vivante qui relie passé, présent et futur.